|
|
LES CONSEILS DU CLEMI
|
Intéresser son lecteur et l'informer
Ces conseils aux journalistes juniors des collèges et lycées
un petit guide du rédacteur. Ils abordent les principaux
genres journalistiques et les étapes de rédaction d'un
article.
Vos contacts: Pascal Famery et Carole Hourt
|
|
Intéresser,
capter et retenir l’attention de ses lecteurs est le credo de tout journaliste
: lire demande un effort. Pour réussir, il dispose de techniques
précises. Mais il ne suffit pas d’écrire de bons papiers
pour être lu. Il faut savoir « mettre en scène »
les textes produits. Une page de journal n’est pas une suite de textes
juxtaposés au petit bonheur la chance, elle a une unité.
Nous vous proposons donc quelques conseils pour mieux réaliser
vos travaux. Toutefois avant de vous lancer dans l’aventure, ouvrez des
journaux, regardez leur composition, leur structure, tout ce qui attire
le regard. Certains vous séduiront d’autres vous rebuteront...
… Alors au moment de votre réunion de rédaction pensez
à vos futurs lecteurs. C’est là que tout se décidera
:
– choix des articles et de la maquette,
– choix des traitements et de l’iconographie.
Une fois les tâches réparties, imprégnez-vous
des quelques recommandations qui suivent, et n’hésitez pas, vous
êtes des journalistes.
|
|
|
D’abord, vous achetez un journal. Plusieurs journaux.
Feuilletez-les : ils sont bien différents les uns des autres.
Leur format, leur style, leurs titres ou leurs photos : tout diffère.
Une seule chose leur est commune : ils ont chacun une personnalité,
une unité de ton et une cohérence qui leur sont propres.
Voyez ce titre, à la une. Mesurez son étendue et sa
portée. Regardez ici la place que tiennent les photos. Tiens !
là, il n’y en a aucune. Appréciez la fantaisie de cette mise
en page. Et l’austérité de celle-ci, brrrr ! Suivez la rubrique
gastronomique, au fil des jours (aucun risque de grossir). Souriez à
la lecture de ce surtitre, tout plein d’humour.
Evaluez la surface de pub. C’est le nerf de la guerre. Vous le savez
bien.
Examinez « à la loupe » les bons ou les mauvais
caractères. Offrez-vous une brochette de brèves le long
de ce gros article qui vous fait peur. Cherchez comment l’information,
au bout du compte, est « habillée ». Dénombrez
les colonnes, les lignes, les mots, les signes... Démontez tout. Et
amusez-vous à remonter la une vous-mêmes. Vous verrez bien.
Vous y voyez plus clair, beaucoup plus clair, jetez-vous à l’eau
: le prochain journal, c’est le vôtre !
|
|
Utilisez toute la palette des genres
|
|
Le genre journalistique est lié au moyen
dont l’information est collectée et à son mode d’écriture
ou de réalisation. Voici les principaux genres.
 La brève répond en un minimum de mots aux questions
essentielles : qui ? quoi ? quand ? où ? éventuellement :
comment ? et pourquoi ? C’est une information sans titre sur un fait d’actualité.
Une brève est rarement seule, mais présentée dans
un ensemble de brèves.
La brève répond en un minimum de mots aux questions
essentielles : qui ? quoi ? quand ? où ? éventuellement :
comment ? et pourquoi ? C’est une information sans titre sur un fait d’actualité.
Une brève est rarement seule, mais présentée dans
un ensemble de brèves.
 Le reportage constitue le genre journalistique par excellence.
Il s’agit de rapporter des informations collectées au plus près
de l’événement, dans le temps comme dans l’espace. Le reporter
(francisé aujoud’hui en reporteur) doit s’imprégner au maximum
d’un sujet : il est dans l’événement, faisant jouer tous
ses sens perceptifs. Son mode d’écriture sera donc très descriptif,
utilisant un vocabulaire coloré, qui donne à voir au lecteur.
Celui-ci doit avoir l’impression « d’y être ».
Le reportage constitue le genre journalistique par excellence.
Il s’agit de rapporter des informations collectées au plus près
de l’événement, dans le temps comme dans l’espace. Le reporter
(francisé aujoud’hui en reporteur) doit s’imprégner au maximum
d’un sujet : il est dans l’événement, faisant jouer tous
ses sens perceptifs. Son mode d’écriture sera donc très descriptif,
utilisant un vocabulaire coloré, qui donne à voir au lecteur.
Celui-ci doit avoir l’impression « d’y être ».
 L’interview consiste à interroger quelqu’un de représentatif
d’un sujet, ou tout au moins quelqu’un dont les propos sont censés
être significatifs. Ce genre est très approprié au
souci de vulgariser car il fait appel au langage parlé et à
la spontanéité. Il est donc explicatif et donne à
entendre.
L’interview consiste à interroger quelqu’un de représentatif
d’un sujet, ou tout au moins quelqu’un dont les propos sont censés
être significatifs. Ce genre est très approprié au
souci de vulgariser car il fait appel au langage parlé et à
la spontanéité. Il est donc explicatif et donne à
entendre.
 Le compte rendu résume un fait – spectacle, ouvrage ou
audience de tribunal, par exemple. Le journaliste rend compte sous la forme
d’un récit, dans un style synthétique, il donne à comprendre.
Le compte rendu résume un fait – spectacle, ouvrage ou
audience de tribunal, par exemple. Le journaliste rend compte sous la forme
d’un récit, dans un style synthétique, il donne à comprendre.
 L’enquête recourt à ces trois genres. C’est plutôt
l’artillerie lourde, elle vise à cerner un sujet de manière
approfondie, à faire le point sur une question. Voir, entendre,
comprendre.
L’enquête recourt à ces trois genres. C’est plutôt
l’artillerie lourde, elle vise à cerner un sujet de manière
approfondie, à faire le point sur une question. Voir, entendre,
comprendre.
 Le billet est un article d’humeur, qui se veut souvent d’humour.
Genre périlleux par excellence, il mélange légèreté
et gravité, dans un style elliptique. Il interroge en donnant à
réfléchir.
Le billet est un article d’humeur, qui se veut souvent d’humour.
Genre périlleux par excellence, il mélange légèreté
et gravité, dans un style elliptique. Il interroge en donnant à
réfléchir.
 L’éditorial donne le point de vue de l’éditeur
et même celui du journal ; on dit donc qu’il engage la rédaction.
C’est l’écrit plutôt officiel, parfois pompeux, qui donne
à penser en tirant plutôt vers l’avenir.
L’éditorial donne le point de vue de l’éditeur
et même celui du journal ; on dit donc qu’il engage la rédaction.
C’est l’écrit plutôt officiel, parfois pompeux, qui donne
à penser en tirant plutôt vers l’avenir.
|
Sélectionnez l'information
|
|
|
Quel que soit le genre de l’article qu’on choisit d’écrire, il
faudra prévoir un temps pour rassembler des documents, rechercher
des sources, recueillir les informations qu’on rédigera.
Avant de se lancer dans l’article, déterminer un angle
(exemple : si je veux faire un article sur une radio locale, je peux
retenir l’organisation de la station ou le portrait du rédacteur
en chef ou l’histoire de cette radio, ou plusieurs de ces angles traités
dans des papiers séparés).
Pour un reportage, se documenter auparavant sur le sujet choisi,
prendre quelques rendez-vous par téléphone (mais pas trop
!) pour inclure une ou des interviews.
Pour une interview : bien choisir l’interviewé, préparer
quelques questions mais se laisser guider par l’évolution de l’entretien.
Emporter un magnéto mais veiller à ne pas enregistrer trop
de choses.Limiter le temps de l’interview. Se munir surtout d’un carnet
pour prendre des notes bien organisées. Ouvrir ses yeux, ses oreilles
et sa mémoire, et noter les détails qui rendront vivantes
les situations (un silence qui s’établit, la grimace d’un interlocuteur,
la qualité de l’atmosphère dans une réunion, etc.).
Penser toujours à l’article qu’on va écrire : se concentrer
sur l’information dont on a besoin et laisser de côté ce
qui n’est pas dans l’angle choisi.
Ne pas remettre à plus tard la rédaction de l’article
et utiliser sa mémoire encore toute chaude !
|
|
|
Accrocher et intéresser le lecteur est
un art. Il s’apprend. Il utilise quelques ficelles bien utiles à
connaître.
 Toujours se souvenir du public auquel on s’adresse : Quels thèmes
peuvent l’intéresser ? Comment les aborder ? De quelles informations
dispose-t-il déjà sur le sujet ?…
Toujours se souvenir du public auquel on s’adresse : Quels thèmes
peuvent l’intéresser ? Comment les aborder ? De quelles informations
dispose-t-il déjà sur le sujet ?…
 Avant
de rédiger, bien définir le « message essentiel »
de l’article : après avoir réuni toutes les données
nécessaires, on doit pouvoir écrire en quelques mots l’idée
fondamentale que l’on veut communiquer. Ce message doit arriver rapidement
dans l’article. Eviter d’introduire longuement le sujet. Penser au lecteur
qui risque de se lasser.
Avant
de rédiger, bien définir le « message essentiel »
de l’article : après avoir réuni toutes les données
nécessaires, on doit pouvoir écrire en quelques mots l’idée
fondamentale que l’on veut communiquer. Ce message doit arriver rapidement
dans l’article. Eviter d’introduire longuement le sujet. Penser au lecteur
qui risque de se lasser.
 Trouver un fil conducteur : Il structure l’article, évite
les répétitions, fournit un plan.
Trouver un fil conducteur : Il structure l’article, évite
les répétitions, fournit un plan.
Dans les journaux, souvent, le plus important est placé au
début (qui ? où ? quand ? pourquoi ? comment ?). Puis viennent
des développements successifs qui précisent l’information
par ordre d’intérêt décroissant.
 Être vivant
Être vivant
• ne pas hésiter à intercaler
dans le corps de l’article de courts extraits d’interviews ou d’opinions
en style direct,
• privilégier le présent,
• originalité et humour sont des ingrédients précieux.
 Être clair et concis
Être clair et concis
• expliquer les sigles utilisés,
• présenter, même brièvement, les personnes interviewées
ou citées,
• faire des phrases courtes,
• travailler la densité ; pas de tournures inutiles du genre
« il convient également de souligner », « notons
encore »…
SOIGNER SIX POINTS IMPORTANTS :
 Le titre : Important car il donne envie de
lire l’article. Il peut être plutôt incitatif (titre amusant
ou bizarre qui renseigne peu sur le contenu de l’article) ou plutôt
informatif (beaucoup de renseignements sur l’essentiel de l’information
traitée dans l’article). Il peut être précisé
ou renforcé par un surtitre et un sous-titre. C’est souvent plus
facile à plusieurs, une fois l’article rédigé.
Le titre : Important car il donne envie de
lire l’article. Il peut être plutôt incitatif (titre amusant
ou bizarre qui renseigne peu sur le contenu de l’article) ou plutôt
informatif (beaucoup de renseignements sur l’essentiel de l’information
traitée dans l’article). Il peut être précisé
ou renforcé par un surtitre et un sous-titre. C’est souvent plus
facile à plusieurs, une fois l’article rédigé.
 Le chapeau : Quelques lignes de texte. Elles
résument l’essentiel de l’information et incitent à lire
le reste.
Le chapeau : Quelques lignes de texte. Elles
résument l’essentiel de l’information et incitent à lire
le reste.
 L’attaque : C’est la première phrase de l’article
proprement dit. Souvent une phrase bien travaillée, parfois un ou
quelques mots. Il faut débuter sans hésiter : originale,
brève et rythmée, l’attaque accroche le lecteur.
L’attaque : C’est la première phrase de l’article
proprement dit. Souvent une phrase bien travaillée, parfois un ou
quelques mots. Il faut débuter sans hésiter : originale,
brève et rythmée, l’attaque accroche le lecteur.
 Les intertitres : Quelques mots qui jalonnent
le texte de l’article toutes les trente à quarante lignes. Ils
sont souvent tirés du texte.
Les intertitres : Quelques mots qui jalonnent
le texte de l’article toutes les trente à quarante lignes. Ils
sont souvent tirés du texte.
 La chute : C’est la dernière phrase de l’article.
Souvent une phrase courte et travaillée, comme l’attaque. Importante
car c’est l’impression finale que le lecteur garde de l’article : au bout
du compte, quel sentiment veut-on lui laisser ?
La chute : C’est la dernière phrase de l’article.
Souvent une phrase courte et travaillée, comme l’attaque. Importante
car c’est l’impression finale que le lecteur garde de l’article : au bout
du compte, quel sentiment veut-on lui laisser ?
 Les légendes et les sources : À ne
pas oublier si vous proposez des photos ou dessins.
Les légendes et les sources : À ne
pas oublier si vous proposez des photos ou dessins.
|
Mettre en page...
... c'est faire respirer votre journal
|
|
La page est une image (par forcément sage),
et votre mise en page, belle et attrayante, incitera le lecteur à
plonger, sans hésiter, dans le vif du sujet : l’information.
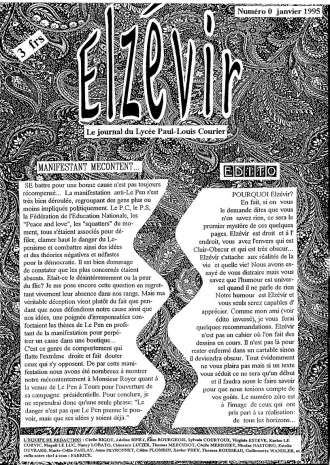
La mise en page tient à la fois de l’art et de la technique.
Elle doit allier, en un même mouvement, trois qualités de
base :
 La lisibilité :
La lisibilité :
– ne pas entasser le maximum de choses dans
le minimum de place;
– faire attention à l’espace vide autour du texte (les blancs)
on « aère »...;
– éviter une trop grande masse de texte d’un bloc;
– couper le texte par des intertitres, des alinéas...;
– hiérarchiser l’information et placer les articles, selon
l’importance qu’on leur accorde, dans la page et dans le journal;
– ne pas jongler avec les polices de caractères (monotonie
ou trop grande diversité).
 L’équilibre :
L’équilibre :
– éviter la juxtaposition gratuite
des textes à l’intérieur d’une même page;
– adapter le titre à l’article qu’il introduit (grosseur,
genre...);
– choisir avec soin l’emplacement d’une photo, d’une illustration
(sans les multiplier...);
– éviter les symétries faciles (horizontales, verticales...);
– veiller à harmoniser la force de corps (grosseur du caractère)
et la justification (largeur de la colonne).
 L’unité :
L’unité :
– organiser l’ensemble d’une page, comme l’ensemble
du journal, pour avoir un tout ordonné et cohérent;
– choisir d’utiliser le même « ton », le même
style, dans la présentation, le titrage...;
– le tout doit être un juste équilibre entre visuel
et rédactionnel.
|
|
|
• Faire
son journal au lycée et au collège, par
Odile Chenevez, Pascal Famery et le Clemi, Victoire éditions,
nouvelle édition 2005. Un guide pratique et concret pour les jeunes qui se lancent
dans l'aventure du journal.
• Journaux scolaires et lycéens de Jacques
Gonnet.- Éd. Retz. Pour ceux qui veulent tout savoir
sur l’histoire et le contenu des journaux scolaires.
|
|
|