|
 le
sommaire de la semaine le
sommaire de la semaine
 d'autres témoignages
(suite)
d'autres témoignages
(suite)
DES
TÉMOIGNAGES D'ENSEIGNANTS
|
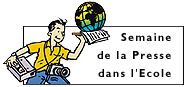
Activités
menées dans les classes lors des dernières
semaines de la Presse dans l'Ecole
Vous
pouvez télécharger l'ensemble
de ces témoignages dans une version
imprimable (rtf).
|
|

|
"
INFORMER, C'EST CHOISIR"
Témoignage
de Chris Trabys, documentaliste du lycée Blaise-Pascal,
à Brie-Comte-Robert. |
|
|
Pensée
dès le mois de juin 1999 et portée par une
forte mobilisation, la 11e semaine de la Presse dans l'Ecole
a été riche de rencontres et de projets. Inscrite
au projet d'établissement depuis trois ans dans le
cadre d'une ouverture culturelle et citoyenne, cette Semaine
suscite une mobilisation croissante de l'ensemble de la
communauté éducative, qui a dépassé
cette année le cadre des enseignants. La multiplicité
des rencontres et la large diffusion, au sein de l'établissement,
de certaines actions, ont fortement contribué à
la faire exister et apprécier. En voici quelques
exemples.
 Etude de la diversité de l'information dans les quotidiens
nationaux
Etude de la diversité de l'information dans les quotidiens
nationaux
Le
cadre
Travail mené avec des élèves de seconde,
encadrés par un professeur d'histoire-géographie
et une documentaliste, dans le cadre des "modules". Durée:
5 semaines.
Objectifs: faire découvrir la notion de "ligne éditoriale",
développer l'esprit critique des élèves,
mettre en valeur la richesse de la presse écrite,
mettre en évidence le nécessaire pluralisme
de la presse garant de la démocratie.
Déroulement
du projet
- Analyse des unes (étude comparative): composition,
fonction, hiérarchie de l'information, ligne éditoriale,
public visé.
- Un événement dans la presse: analyse de
la diversité du traitement de l'information sur un
même événement dans plusieurs quotidiens
nationaux.
- Rencontre-débat avec Jean-Yves Averso du Parisien
(édition de Seine-et-Marne) et de Karelle Menine
(L'Humanité).
Bilan
Trois points montrent la réussite du projet: l'intérêt
des élèves et leur implication, le dynamisme
des journalistes pendant la rencontre, la différence
des lignes éditoriales des journaux qu'ils représentaient.
 Informer, c'est choisir
Informer, c'est choisir
Le
cadre
Travail mené avec des élèves de seconde,
encadrés par un professeur d'histoire-géographie
et une documentaliste, dans le cadre des "modules". Durée:
3 semaines.
Objectifs: montrer que l'information télévisuelle
et radiophonique résulte de choix, comprendre ces
choix pour devenir des auditeurs et téléspectateurs
critiques.
Déroulement
du projet
- Analyse comparative des choix effectués sur TF1,
France2 (journal de 20h), France Inter, RTL (journal de
13h) sur une semaine.
- Rencontre avec Thierry Hay (France 2) et Frédéric
Barrère (France Inter). A partir d'une liste de sujets
traités dans les quotidiens du jour, les élèves,
divisés en deux groupes, ont, lors de conférences
de rédaction dirigées par les journalistes,
établit un conducteur pour le journal du soir.
Bilan
Une activité à renouveler. C'est un exercice
concret avec les journalistes qui permet de rentrer rapidement
dans le vif du sujet et de faire mieux comprendre les messages
fondamentaux et les notions de base.
 Une revue de presse murale
Une revue de presse murale
Le
cadre
Travail mené avec des élèves de trois
classes de seconde pendant le cours de sciences économiques
et sociales (SES). Durée: étalement progressif
depuis le mois de novembre.
Objectifs: amener les élèves à hiérarchiser
l'information et faire des choix, les inciter à s'intéresser
à l'actualité.
Déroulement
du projet
- En amont de la semaine de la presse: réalisation
de revues de presse murales hebdomadaires affichées
au CDI.
- Pendant la semaine: revues de presse murales quotidiennes
exposées au CDI, dans les couloirs et le hall du
lycée.
Bilan
Un affichage étendu à plusieurs espaces a
contribué à faire exister plus concrètement
la semaine de la presse dans le lycée.
 Une revue de presse internationale
Une revue de presse internationale
Le
cadre
Travail mené avec des élèves d'une
classe de seconde, une classe de première et une
classe de Terminale BEP, encadrés par quatre professeurs
de langues (allemand, anglais, espagnol, portugais), deux
professeurs de français, un professeur de communication/bureautique,
la documentaliste, le conseiller principal d'éducation.
Participation du club multimédia (deux élèves
et un surveillant) pour la partie technique au moment de
la réalisation. Cadre: modules et cours. Durée:
d'octobre à mars.
Objectifs:
valoriser l'enseignement des langues par une production
orale, réunir plusieurs classes et acteurs de la
vie de l'établissement autour d'un projet, familiariser
les élèves avec la lecture du journal, les
sensibiliser à l'actualité et au pluralisme
de la presse.
Déroulement
du projet
- Lire le journal: organisation et hiérarchie de
l'information, mise en page, écriture journalistique,
différents types d'articles, titres, illustrations.
Les premières séances sont effectuées
avec des journaux français, de manière à
familiariser les élèves avec l'information
dans la presse écrite.
- Décrypter une revue de presse à la radio:
repérage des sujets, notions d'angles, mise en forme,
identification des sources.
- Réaliser une revue de presse: nombreuses séances
consacrées à un apprentissage de la technique
de la revue de presse.
- Banalisation d'une matinée pendant la semaine de
la presse, pour les élèves et enseignants
concernés par le projet : par groupes, les élèves
réalisent leur revue de presse dans les différentes
langues, l'enregistrent et la diffusent dans le lycée.
- Rencontres avec des journalistes (Eric Delvaux, France
Inter, et Pierre Billaud, RTL).
 [Haut] [Haut]
|
"CONCOURS
EN STOCK" : Un collège en ébullition
Collège
de Semur-en-Auxois. Compte rendu extrait du rapport
national de la 10e semaine de la presse dans l'école
|
|
|
"Plume
d'Or", "Crayon d'Or", "Bobineau d'Or", "Objectif d'Or":
tous ces prix sont pour le collège de Semur-en-Auxois.
Jour après jour, les résultats tombent. Voir
les visages des élèves et des professeurs
s'illuminer nous comble de joie. La semaine de la Presse
1999? Un bon millésime pour le collège de
Semur.
Depuis
cinq ans déjà, le centre d'information et
de documentation (CDI) s'investit pendant cette Semaine
médiatique. Rédaction de Unes à partir
de dépêches d'agences, accueil de journaliste
locaux, production d'un quatre pages, échange d'articles
avec un collège de Mayotte, étude d'un événement
à travers différents journaux écrit,
radio ou télévisé, tiercé des
titres, rédaction de Unes en espagnol, visite du
Bien Public... L'étude de la presse, c'est toujours
passionnant! Mais avec les concours du Clemi, c'est encore
plus stimulant.
Notre collège s'est inscrit pour la première
fois en 1998 aux concours du Clemi académique et
les résultats étaient encourageants: "Crayon
d'argent", "Objectif spécial", 3e place pour "Fax
en stock". Alors cette année, quand j'ai proposé
à mes collègues de s'inscrire, ils ont été
motivés. Pour "Zoom en stock" (concours de reportages
photo), "Bob en stock" (concours de reportages radio), "Vox
en stock" (concours d'interview radio), les collègues
ont travaillé pendant plusieurs semaines sur la photo
de presse et le journal radio avec leurs élèves
de quatrième en parcours diversifié. Fax en
stock (concours de pages de journal) donnait au professeur
des quatrièmes "option techno" l'occasion idéale
de mettre en pratique l'apprentissage de Publisher. Quant
à notre élève "Crayon d'Or", il avait
déjà envoyé un dessin l'année
dernière pour "Croq' en stock" (concours de dessin
de presse).
 Le lundi 15 mars, nous sommes tous dans les starting
blocks.
Le lundi 15 mars, nous sommes tous dans les starting
blocks.
Premier concours: "Vox en stock". Il s'agit d'interviewer
par téléphone, pendant trois minutes, une
personnalité choisie par le partenaire, Europe 2
Le Creusot. Cette année, c'est Daniel Herrero, entraîneur
du RC Toulon. Les deux élèves inscrits arrivent
au CDI à l'heure prévue. Ils ont étudié
la biographie de Daniel Herrero pendant le week-end. Nous
revoyons ensemble leurs questions. Ils s'enregistrent, repassent
la bande, modifient quelques mots. Sérieux, concentrés,
montre en main, ils attendent auprès du téléphone,
avec haut-parleur. L'interview s'écoule, Clément
raccroche et nous résume l'interview. Il a trouvé
Herrero sympathique, c'était une expérience
intéressante.
 Mardi 16 mars, le jour du cadeau.
Mardi 16 mars, le jour du cadeau.
Aujourd'hui, pas de concours, mais c'est le jour cadeau:
un plein carton de périodiques à déballer.
Montagne, pêche, chats, motos, histoire, informatique,
actualité... Chacun y trouve sa passion. Les élèves
ouvrent de grands yeux: "eh oui, c'est la semaine de la
presse dans l'école". On enlève les magazines
de 1998, la presse 1999 est arrivée!
 Jeudi 18, le grand jour.
Jeudi 18, le grand jour.
"Fax en stock" pour le soir, "Zoom en stock" à boucler
et "Croq' en stock" à relancer.
8h15. Le sujet de Fax en stock est tombé, par télécopie.
"La différence". Vaste question!
8h35. L'encadrement est au complet: professeur de français,
de technologie et aide éducatrice.
8h40. Les élèves arrivent, prennent connaissance
du sujet. Questionnement: différence physique, intellectuelle,
religieuse... marginalité, toxicomanie (intéressant
mais encore tabou, personne ne voudrait répondre),
et racisme... Deux groupes se constituent: l'un rédigera
un portrait d'Aurélie, une camarade de quatrième
atteinte d'amyotrophie spinale. L'autre s'intéressera
au racisme. Chacun choisit son rôle: documentation,
interview, illustration, mise en page, rédaction
en chef. Des élèves interrogent BCDI. Grâce
aux Clés de l'actualité et à Okapi,
les documents sur les maladies génétiques
et le racisme ne manquent pas. Quelques uns cherchent Aurélie
pour l'interviewer. Un autre numérise une photo du
dernier Téléthon avec l'aide éducatrice,
pendant que la rédactrice en chef soigne son attaque
avec les conseils du professeur de français. A midi,
le travail est bien avancé. Heureusement car l'après
midi sera fiévreux au CDI.
13h. Les équipes de "Zoom en stock" débarquent.
Certaines photos sont inutilisables, surexposées.
Il faut les refaire. En route pour la ville avec l'appareil
numérique: les situations doivent être identiques
à celles des clichés précédents,
car les légendes sont déjà rédigées.
Le temps presse, il reste une heure avant la fin des cours.
16h30. Retour à temps au CDI en pleine ambiance de
bouclage. Impossible d'enregistrer un article pour le faire
passer sur un poste relié au réseau: la principale
revient de son bureau avec une disquette. Ouf! ça
marche! On tire les nouvelles photos: elles sortent sans
trop de vert. Vite des ciseaux, de la colle: c'est terminé.
Le professeur de technologie aide les élèves
à terminer la saisie du dernier article. On imprime:
du beau boulot!
17h40. Fin des cours. Les élèves repartent
contents de leur travail et de leur journée. Ils
se sont bien donnés. Correction des dernières
fautes d'orthographe avant de faxer les articles. Et si
on gagnait?
 Vendredi 19 mars matin, ça continue.
Vendredi 19 mars matin, ça continue.
8h40. "Bob en Stock". En attendant Emilie Flahault, reporter
à Radio France Bourgogne, des enseignants présentent
les différentes radios aux élèves de
quatrième.
9h00. La journaliste arrive avec son Nagra. Elle montre
le matériel aux élèves, explique les
ficelles du métier. Elle revoit les questions que
François, notre reporter du jour, compte poser à
un héliciculteur au salon de l'Auxois. Tout le monde
se met en route. De retour au collège, Emilie Flahault
fait le montage avec les élèves qui "mordent"
vraiment. Elle déroule la bande, interroge, coupe,
colle, minute. Même le plus goguenard est conquis
et sort du CDI enrichi de nouvelles connaissances. Pendant
la récréation, la journaliste fait son reportage
sur la semaine de la presse dans l'école. Nous rassemblons
les élèves de quatrième option techno:
chapô, intertitres, attaque... ils n'ont rien oublié!
12h. Les concours sont finis. Il ne reste plus qu'à
poster soigneusement tous les travaux. Encore une semaine
de la presse riche en émotions, partages, apprentissages.
Merci le Clemi. La semaine suivante, les lauriers couronnent
nos espoirs. "Mais non, on n'a pas soudoyé les jurys!".
J'ai même entendu dire que le principal nous avait
promis d'arroser ça au champagne. Ce serait bien
mérité, non?!
retour
à la liste des témoignages
 [Haut] [Haut]
|
"VOUS
PRENDREZ BIEN UN PETIT VERRE D'ACTUALITÉ"
Lycée
Paul-Cornu, Lisieux. Extrait du rapport national de
la 10e semaine de la presse dans l'école
|
|
|
Mardi
16 mars 1999, "café-débat" au lycée
Paul Cornu à Lisieux. Elèves, professeurs,
tous sont invités à venir discuter autour
d'un café des relations entre la presse et le pouvoir.
Une nouveauté dans ce lycée qui accueille
plus de 1.500 jeunes. Et ce premier rendez-vous a été
consacré à la presse.
Cette
action particulièrement originale a été
animée par les documentalistes, un professeur de
philosophie et un journaliste de Ouest France, au centre
d'information et de documentation du lycée. Thème
choisi: "les lycéens veulent savoir la vérité!"
Informer sans déformer, liberté d'expression,
respect de la démocratie, les lycéens exigent
une chose: la Vérité.
Le
sujet a été abordé sous tous ses angles:
informer sans déformer, la liberté d'expression,
ses limites, le respect de la démocratie… Et
les réflexions sont spontanées. "Comment le
journaliste peut-il respecter le témoignage de son
interlocuteur? demande un élève. On déforme
forcément les choses. La presse ne peut pas garantir
une objectivité totale."
Les
remarques et les idées s'enchaînent, divisent
les uns, rassemblent les autres.
Le
droit à l'image, la hiérarchie de l'information
entrent dans le débat. "Pourquoi choisir de présenter
telle ou telle information, de la mettre en valeur?" Les
lycéens sont curieux de connaître le métier
de journaliste pour comprendre la réalisation d'un
journal.
L'avenir
des supports de diffusion, l'évolution technologique
posent aussi de nouvelles questions. "Se sert-on beaucoup
d'Internet? Les informations sont-elles établies
de source sûre? Peut-on être floué?"
Et les médias de demain: la presse écrite
va-t-elle résister à l'ère de l'informatique
et de l'audiovisuel?
Tous
disent aimer la presse (on a même parlé de
la création d'un journal scolaire) mais ne cachent
pas se méfier de la réalité des faits
exposés. La presse, on n'en attend qu'une chose:
c'est la vérité.
retour
à la liste des témoignages
 [Haut] [Haut]
|
"IMAGE
D'AFRIQUE", une opération Clemi-Vétérinaires
sans frontière
Travail proposé aux enseignants par l'équipe
Clemi de Lyon. Extrait du rapport national de la 10e
semaine de la presse dans l'école
|
|
|
Les
élèves doivent réaliser la Une d'un
journal, un article de presse ou un roman-photos à
partir de photos de Vétérinaires sans Frontières
et d'Afric'Impact. Le but est d'amener les élèves
à réfléchir à leurs représentations
du continent africain.
L'Afrique
est diversité. Pourtant, les élèves
ne sont pas étonnés quand on parle d'"habitat
traditionnel africain". Ils le seraient sans doute s'ils
entendaient parler d'une "maison typiquement européenne",
alors que ce continent est bien plus petit que l'Afrique.
Le
travail consiste donc à amener les élèves
à "lister" les représentations qu'ils ont
de l'Afrique. A se demander pourquoi ils l'imaginent ainsi.
Et à les inciter à s'interroger sur le rôle
que les médias jouent dans la construction des représentations
mentales, en diffusant le plus souvent des images de famine,
d'aide alimentaire, de guerres et de conflits ethniques.
Un travail autour des photos permet donc aux élèves
de réaliser qu'il existe différentes cultures
africaines et différentes formes de développement.
Les
enseignants ont parfois demandé aux élèves,
à l'issue du travail, quelles représentations
mentales ils avaient d'autres espaces, lointains comme les
Etats-Unis ou proches comme les banlieues françaises,
et ont tenté de les confronter à la réalité.
Les
photos ont également permis d'explorer avec les élèves
d'autres pistes: le mode de vie, l'agriculture, l'élevage,
la famille, l'habitat en Afrique.
retour
à la liste des témoignages
 [Haut] [Haut]
|
"QU'AS
TU APPRIS À PROPOS DES MÉDIAS ?": les
collégiens évaluent leur Semaine
Compte rendu de la documentaliste
du collège Anne-Frank, Mulhouse. Extrait du rapport
national de la 10e semaine de la presse dans l'école
|
|
|
Cette
semaine représente un temps fort dans toute une année
de travail. Inscrit à la semaine de la Presse parmi
les 16.000 autres établissements scolaires français,
le collège a pleinement valorisé le projet
pédagogique mené par les enseignants.
Le
collège Anne Franck a mené toute l'année
scolaire un travail de fond sur les médias:
- exploitation d'une exposition de Unes du quotidien régional
L'Alsace par sept classes et travail de création
sur la Une,
- participation de deux classes au concours "Grands Reporters"
des Dernières Nouvelles d'Alsace: l'une a été
primée et invitée à visiter les locaux
strasbourgeois du quotidien,
- création d'un journal de collège,
- participation de deux classes à l'action "Journal
au collège" avec L'Alsace et visites des locaux du
quotidien pour quatre groupes,
- découverte des studios de France3 Alsace à
Strasbourg par une classe de cinquième.
 Le travail entrepris
Le travail entrepris
Un
grand nombre de magazines (revues spécialisées
sur le deux-roues, les animaux, les sports, revues pour
la jeunesse) a été obtenu gratuitement auprès
des éditeurs de presse et analysé par les
élèves.
Des quotidiens nationaux du même jour permettaient
de comparer les différentes approches de l'information.
Cette collection a été exploitée en
histoire-géographie avec une classe de quatrième.
Des journaux étrangers ont permis aux élèves
de découvrir la presse d'autres pays qui sont, pour
certains, leur pays d'origine.
Six journalistes de la presse écrite et parlée
sont venus à la rencontre de 171 élèves,
soit sept classes. Quatre professeurs ont encadré
les huit heures de dialogue: tous les journalistes attendus
étaient au rendez-vous et le contact avec les jeunes
a été chaleureux. Tous les élèves
de quatrième ont posé leurs questions à
un journaliste (rappelons que la presse figure au programme
de ces classes). En réponse à la demande des
professeurs ou pour compléter le travail déjà
entrepris, une troisième et deux cinquième
ont bénéficié de l'intervention d'un
professionnel des médias.
Une fiche d'évaluation élève, éditée
par le Clemi national et distribuée à tous
les participants, a permis de cerner les retombées
d'une telle action ainsi que les attentes des élèves.
 Qui a participé?
Qui a participé?
-
Les 140 fiches d'évaluation retournées par
les élèves font apparaître que la majorité
d'entre eux a amélioré sa connaissance des
médias (59%), a découvert un ou des métiers
de l'information (63,5%) et pense que s'informer, c'est
important (76%). Beau succès également pour
la presse régionale souvent mentionnée spontanément
au chapitre des journaux particulièrement intéressants
(81 fois cités, les deux titres confondus). Un élève
de cinquième justifie même son intérêt
en écrivant: "C'est mon journal favori".
- Ce sont les professeurs de français qui ont préparé
les débats et encadré les élèves.
- René Bickel, journaliste aux Dernières Nouvelles
d'Alsace (DNA), a ouvert les débats avec des élèves
de quatrième qui ont posé des questions astucieuses
au journaliste et au photographe qui l'accompagnait. Un
article sur cette première rencontre a été
publié dans les DNA du lendemain.
Gilles Haubensack, de L'Alsace, journaliste connu des élèves
de quatrième et de cinquième, a rencontré
la classe de cinquième qui connaissait les DNA pour
avoir participé au concours "Grands reporters. Ainsi
ont-ils découvert la pluralité de la presse
et mieux cerné le métier de journaliste.
Pascal Kury, de RTL 2, a tenu en haleine les élèves
de deux classes de quatrième pendant une heure chacune.
La rencontre s'est terminée par une interview des
élèves et de la documentaliste, diffusé
le lundi 22 mars. Les élèves l'ont trouvé
le journaliste si sympathique que, deux jours plus tard,
ils ont demandé quand il reviendrait …
Alain Cheval, de NRJ, a été reçu ce
même après-midi par les élèves
de troisième. Par son charisme et sa popularité
parmi les jeunes, il a captivé son auditoire et a
été assailli par les demandes d'autographes
à l'heure de la récréation.
David Madinier, de Nostalgie, Manuel Goetz, d'Europe2, ont
reçu le même accueil. Après la presse
écrite et avant la visite de France 3, le point de
vue d'un journaliste de la radio a soulevé beaucoup
d'intérêt. D'autant plus que le dernier invité
avait écouté un bulletin d'informations radio
réalisé par toute la classe une dizaine de
jours auparavant.
 Quelques résultats de l'évaluation des
élèves
Quelques résultats de l'évaluation des
élèves
-
A la question "Qu'as-tu appris à propos des médias?",
59% ont répondu. Leurs découvertes portent
sur le métier de journaliste, les contenus de la
presse, la déontologie et la pluralité. 47%
des élèves ont vu des journaux qu'ils ne connaissaient
pas et 18,5% mentionnent la presse étrangère.
31,4% des participants ont découvert des émissions
de radio ou de télévision.
63,5% (89 élèves) reconnaissent avoir découvert
ou déclarent mieux connaître un ou des métiers
de l'information: le plus souvent cité est celui
de journaliste, mais on trouve aussi le photographe, l'illustrateur,
le rédacteur en chef ainsi que les métiers
de l'imprimerie, l'informatique et la mise en page.
- Des idées pour la prochaine semaine de la presse:
"J'aimerais passer à la télé", "faire
venir des célébrités, "parler sur les
stars", du Canada, d'Internet ou encore, "davantage de débats
avec des personnes extérieures pour des faits de
société", demande une enseignante.
- Ne perdons pas de vue que l'objectif de ce travail est
d'abord de faire découvrir aux élèves
comment s'élabore l'information. Ce travail permet,
sans doute dans un second temps, d'accéder au débat
d'idées. Visiter des studios, créer une émission
de télévision, faire un reportage qui passe
à la radio, réaliser un journal avec la classe,
"des revues sur les voitures" suggère un élève
de cinquième… "Plus de diversité au niveau
des journaux que l'on puisse lire, qui sont à notre
disposition" demande un élève de quatrième,
alors qu'un autre de la même classe dit ne pas avoir
découvert de journaux: "Je les connaissais presque
tous parce qu'il y en a beaucoup au CDI". Un élève
de quatrième voudrait "que ce soit obligatoire de
visiter un endroit de la presse". Un autre suggère
de "voir toutes les radios et tous les journaux".
Les enseignants seront remerciés de leur investissement
en lisant les remarques positives de quelques élèves
qui ne font aucune suggestion car "c'était déjà
bien cette année"! Les difficultés d'organisation
consistaient à faire coïncider emploi du temps
des classes et disponibilité des journalistes, mais
aussi à veiller à ce que les élèves
ne rencontrent pas les mêmes journalistes que l'année
précédente, malgré l'éclatement
des classes.
Si cette 10e semaine de la presse dans l'école a
été un temps fort en faveur de la connaissance
de l'actualité et des médias, c'est grâce
à la collaboration des professeurs et à la
participation active de journalistes sympathiques et compétents,
qui ont capté l'attention des jeunes et modifié
l'image que ceux-ci se font du monde de l'information.
retour
à la liste des témoignages
 [Haut] [Haut]
|
Dessins,
dépêches et bain de presse: une exposition
dans le hall du lycée
Témoignage
de Catherine Daudé-Miotte, documentaliste du
lycée Clos-Maire. |
|
|
Dans
le hall du lycée Clos-Maire de Beaune, vous ne pouvez
pas y échapper: c'est la semaine de la presse dans
l'école. A votre droite, les kiosques à journaux
vous appellent. Devant vous, six panneaux exposent les travaux
des élèves avec, çà et là,
des caricatures réalisées elles aussi par
les élèves. Arrêtez-vous, ça
vaut la peine !
L'exposition
des travaux réalisés pour cette semaine de
la presse est la deuxième grande expo depuis le début
de l'année scolaire au lycée. La première
célébrait le cinquantenaire de la Déclaration
des droits de l'homme, au mois de décembre. On ne
change pas vraiment de sujet! La liberté de la presse
est l'un des meilleurs indices pour mesurer la qualité
et la quantité de démocratie d'un pays. Il
faut dire qu'ici, au lycée Clos-Maire, on a de bonnes
raisons de penser aux droits de l'homme et à la démocratie.
 Les dessins de presse
Les dessins de presse
Commençons
par les secondes, avec des groupes venant de plusieurs classes
et se retrouvant en option sciences économiques et
sociales. Plein de ciseaux, de bâtons de colle, de
crayons, de feutres, de scotch, et de journaux, de magazines,
de feuilles de chou, tout ce que vous pourrez trouver. Mais
attention: Les journaux doivent dater de 1998. Notre objectif?
Reconstituer l'année écoulée à
travers les dessins de presse. Vous savez bien, ils en disent
parfois beaucoup plus long...
Certains ont profité des vacances de février
pour fouiller la maison, la salle d'attente du dentiste
ou du coiffeur, et puis tiens, il y a aussi la bibliothécaire
de la ville qui peut nous aider. Cela permet, à la
rentrée, d'élargir un peu le choix par rapport
à ce que nous avons au lycée.
Un groupe est chargé de nous fournir le scénario
de cette grande BD: quels ont été les grands
événements de 98, mois par mois? Les autres
doivent écumer les journaux disponibles et sélectionner
les dessins. La vieille photocopieuse du lycée n'arrête
plus!
Le travail s'organise: deux ou trois élèves
pour chaque mois de l'année, et une demi-feuille
de papier par mois pour harmoniser l'ensemble et ne garder
que l'essentiel. Très vite, on s'aperçoit
qu'il faut développer certains événements.
On traitera donc à part les thèmes retenus:
la guerre Irak-Etats-Unis, la guerre au Kosovo, Monica Lewinski,
le cocorico-Mondial, le dopage, les lycéens dans
la rue, la crise financière, les 35 heures. Il faut
sélectionner les meilleurs dessins, trouver un titre
et ne pas oublier de noter sa provenance. Et puis faire
attention à la mise en page. Allez-y, collez!
Ah, ces dessinateurs n'y vont pas de main morte! Mine (!)
de rien, ils nous emmènent très loin, dans
la colère, dans la dérision. Ils ont un autre
regard, une autre manière de "ramasser" l'événement
que celle de leurs confrères journalistes. Comment
imaginer la presse sans ces clins d'oeil, ces rires parfois
grinçants? Il ne nous faut pas moins de 6 grands
panneaux pour exposer la frise chronologique et les thèmes.
Pas mal, le résultat! Mais il aurait fallu restreindre
la gamme des couleurs des feuilles de papier.
 Le "bain de presse" des premières section économique
et sociale
Le "bain de presse" des premières section économique
et sociale
Dans
le même temps, la classe de première économique
et sociale est, elle aussi, dans un "bain de presse". Avec
elle, le programme est chargé!
-
Tout d'abord, nous lançons une enquête sur
"les lycéens et l'information". Les élèves
lui ont trouvé un nom, ce sera "Ne zappe pas, l'info
est là". Et comme on travaille dans le cadre du programme
des Sciences économiques, c'est du sérieux:
il faut faire une étude par classe, sexe, catégorie
socioprofessionnelle de la famille. Vous informez-vous beaucoup,
pas du tout? Que lisez-vous, et comment? Et la télé,
la radio? Etes-vous satisfait? Oui, non, un peu, pas du
tout, à la folie? Très intéressant!
On aimerait tout savoir, pour tout vous dire sur votre façon
-ou plutôt vos façons- de vous informer.
Sur 800 questionnaires distribués classe par classe
(merci à la cellule Vie scolaire du rectorat!), 350
environ sont revenus. Là encore, il faut aller vite
si l'on veut que les résultats soient affichés
pour la semaine de la presse. Classement, dépouillement,
conception au fur et à mesure des tableaux pour les
chiffres bruts, puis les tableaux de pourcentages. Il y
a d'inévitables erreurs: "comment faire quand on
ne trouve pas 100%, Madame?" Chaque tableau doit être
examiné à la loupe, interprété.
Il s'agit de donner du sens à tous ces chiffres.
Tout à la fin, la synthèse des synthèses
nous donne du fil à retordre. Quelles sont les grandes
conclusions de l'enquête? Quelles grandes lignes peut-on
dégager? Bref, comment s'informent les lycéens
du Clos-Maire? On n'oubliera pas d'expliquer comment le
travail a été réalisé, les difficultés
rencontrées.
Au final, l'exposition des résultats de l'enquête
n'occupe qu'un panneau, mais cela ne rend pas compte de
la quantité de travail exigée. Cela a, de
loin, été le plus lourd et le plus difficile.
-
Parallèlement à l'enquête, nous travaillons
avec les dépêches d'agence AFP que nous a envoyées
le Clemi depuis Paris. Nous devons commencer par comprendre,
décrypter tous les codes, les abréviations,
les signes... Nous apprenons le code de priorité,
les lettres indiquant la provenance, la rubrique permettant
d'envoyer très vite la dépêche dans
le service concerné (sport, politique, international,
société), et tout en bas l'heure et le jour.
Plusieurs groupes se constituent: l'un va étudier
le traitement des dépêches dans la presse (dépêches
du 17 février, journaux du 18, au passage, on remarque
le cas à part du journal Le Monde, journal du soir)
et établir les pourcentages de dépêches
traitées dans un seul journal, plusieurs journaux
ou aucun.
Un autre groupe choisit de tracer la trajectoire d'un événement
à travers les dépêches. Cet événement,
ce sont les manifestations kurdes et surtout une dépêche
avec le code de priorité le plus fort, le "1", quand
des Kurdes prennent d'assaut l'ambassade israélienne
à Berlin. Mais qui sont ces manifestants, pourquoi
protestent-ils? Des élèves sont chargés
de rechercher les raisons de leur colère. Un graphique
représente le cours de cette information sur la journée
et chaque dépêche est reliée à
un fil qui représente la courbe sur l'échelle
de 1 à 4 des codes de priorité. Un autre tableau
indique la provenance des dépêches.
Un dernier groupe est chargé d'étudier le
traitement de ces événements dans un large
éventail de journaux.
-
Avec leur professeur de lettres, les élèves
de première s'initient à l'écriture
journalistique. Il s'agit de rédiger un article à
partir de dépêches d'agence. Les sujets choisis
sont le procès de l'excision d'une part et le débat
sur la parité hommes-femmes d'autre part. Un autre
article est rédigé à partir d'une dépêche
incroyable: Monsieur Meurdesoif est condamné pour
ivresse au volant!
-
Enfin, "last but not least", nous avons lancé, par
voie d'affiche dans le lycée, un concours de dessins
humoristiques, façon dessin de presse. Les trois
meilleurs seront récompensés.
 L'intervention d'un journaliste
L'intervention d'un journaliste
Grâce
au Clemi académique, nous contactons Alain Roels,
un journaliste qui vit en Saône-et-Loire. Le 18 mars,
il travaille avec la classe de première économique
et sociale sur la vision critique et comparative de deux
journaux télévisés. Nous réalisons
quelles sont les limites du support télévisuel,
les contraintes de l'image pour le traitement de l'information.
Alain Roels a travaillé à la télévision,
à la radio et pour la presse écrite. Il est
donc bien placé pour expliquer les différences
entre chacun de ces supports. Deux colonnes d'un journal
comme Le Monde représentent 1/2 heure à la
télévision. Voilà qui donne à
réfléchir à tous ceux qui se contentent
du journal télévisé...
 Le kiosque
Le kiosque
Que
serait la semaine de la presse sans un kiosque? Depuis plusieurs
semaines, je suis à la recherche de ce qui pourrait
ressembler le plus à un véritable kiosque
à journaux. Les services techniques de la ville de
Beaune nous proposent de petits stands en bois qui sont
utilisés lors de fêtes ou de manifestations.
Mardi 16 mars, ils font leur apparition dans le hall du
lycée, montés en un clin d'oeil par les ouvriers
du service technique de la ville. Quelques cordes, des pinces
à linge, et nous pouvons installer les journaux et
magazines reçus le matin même. Quelques affiches
publicitaires attirent le chaland et renforcent l'illusion
d'un vrai kiosque. C'est un succès, les élèves
s'approchent et choisissent leur journal. Comme chaque année,
il y en a pour tous les goûts, et même si cela
ne plaît pas à tout le monde, on peut trouver
des titres qui d'habitude n'entrent pas dans les établissements
scolaires. C'est la règle du jeu de cette semaine
de la presse: tout voir, tout lire, au moins une fois, pour
former le jugement et le sens critique de tous les élèves.
Non, les extrêmes ne leur font pas peur et ils sont
capables de comprendre tout le bénéfice que
peut retirer la démocratie de journaux satiriques
dont les dessins ou les titres cherchent à choquer.
Et si quelques exemplaires disparaissent assez vite, c'est
plutôt bon signe! Chaque jour, pendant la semaine,
nous recevons plusieurs exemplaires gratuits du quotidien
régional, Le Bien Public, dans deux éditions
différentes. C'est peut-être un détail
pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup: les
journaux sont remis en place sans intervention de notre
part (il n'y a pas d'adulte en permanence au kiosque), et
aucun n'est laissé sur les bancs du hall. Plusieurs
collègues ont la même idée: ce serait
bien un petit kiosque permanent dans le hall, histoire de
mettre quelques journaux à la disposition des lycéens
toute l'année.
Les
projets pour la semaine de la presse de l'an 2000? Laissez-nous
souffler un peu!
retour
à la liste des témoignages
 [Haut] [Haut]
|
Travailler
sans manuels scolaires, uniquement avec la presse, la
radio, la télévision
Témoignage
de Madame Guerrini, professeur de lettres et responsable
de la journée sans manuels entreprise au collège
Eugène-Lefebvre de Corbie (Somme)
|
|
|
Pendant
une journée de la 9e semaine de la Presse dans l'Ecole,
cinq classes du collège Eugène-Lefebvre de
Corbie ont entrepris de suivre certains de leurs cours uniquement
à partir de la presse écrite et audiovisuelle.
Une entreprise innovatrice en matière d'enseignement
qui a obtenu un véritable succès tant auprès
des professeurs que des élèves des classes
concernées.
 Le
principe et les objectifs Le
principe et les objectifs
Pendant un jour entier de la semaine de la Presse dans
l'Ecole, et à tous les cours prévus ce jour-là,
cinq classes de l'établissement ont travaillé
exclusivement à partir de documents issus de la presse
écrite (journaux, revues, magazines) et audiovisuelle
(radio et télévision).
Un des objectifs était de montrer aux élèves
la cohérence, la continuité dans les enseignements
entre les disciplines en utilisant un support commun. En
même temps, concentrer l'action sur l'emploi du temps
complet d'une journée devait provoquer un effet de
masse, important pour la sensibilisation des élèves,
à qui l'on souhaitait montrer aussi que l'école
peut ne pas être "scolaire"...
 Les
partenaires Les
partenaires
Le Clemi, organisateur de la semaine de la Presse dans
l'Ecole, en la personne de sa coordonnatrice académique,
m'a aidée à chaque instant: mise au point
de l'opération, suggestions, valorisation auprès
des médias, etc.
 La
mise en place La
mise en place
Après sollicitation des collègues et dans
l'espoir de fédérer l'équipe pédagogique
d'au moins une classe, je recueille les propositions des
personnes intéressées et avec l'accord de
l'équipe de direction, de la principale et du principal-adjoint,
la journée d'action retenue est le mardi 17 mars
1998.
 Les
classes engagées Les
classes engagées
Ce jour-là, cinq classes ont travaillé
avec la presse dans toutes les disciplines de la journée:
une 6e, une 5e, une 4e et deux 3e. Comme d'habitude depuis
la création de l'action nationale, plusieurs collègues
d'autres classes s'investissent à titre individuel
dans la semaine de la Presse dans l'Ecole. Les collègues
inscrivent sur l'emploi du temps des classes concernées,
qui a été affiché, le matériel
dont ils ont besoin ce jour-là.
 Les
disciplines concernées Les
disciplines concernées
Français, histoire-géographie, instruction
civique, anglais, espagnol, mathématiques, sciences
de la vie et de la terre (dans cette dernière discipline
et par suite d'un accident survenu au professeur, il n'a
malheureusement pas été possible de mettre
en œuvre le projet que nous avions conçu en
lettres et sciences de la vie et de la terre).
 Matériel
et organisation Matériel
et organisation
Un emploi du temps de la Semaine permet aux collègues
concernés de réserver les journaux et magazines
que nous avons fournis, achetés ou réservés
sur le Minitel.
Ainsi, nous avons à notre disposition:
- Le Courrier picard, quotidien régional,
depuis le début de février 1998;
- Le Monde depuis le début de février
1998;
- 15 exemplaires du Courrier picard des 16 et 17
mars 1998;
- 15 exemplaires du Monde et France-soir datés
du 17 mars 1998;
- 8 exemplaires du Le Parisien du 17 mars 1998;
- 15 exemplaires d'El Pais;
- 15 exemplaires du Sunday times;
- Une journée de dépêches de l'AFP
(du vendredi 13 mars 1998);
- Un important kiosque de journaux et magazines quotidiens,
hebdomadaires, mensuels, etc. et que le documentaliste a
réservés en inscrivant, comme chaque année,
l'établissement à la semaine de la Presse
dans l'Ecole.
 Les
activités Les
activités
En anglais, les élèves de 5e étudient
les journaux et magazines anglais (vocabulaire spécifique,
son utilisation dans des phrases) et les comparent avec
les journaux français. Ils traduisent l'article du
Parisien paru sur la semaine de la Presse au collège.
Une classe de 3e est divisée en quatre groupes. Chaque
groupe composera un dossier sur les quatre thèmes
retenus: le Kosovo, la mode, les sports et la météo,
à partir du Sunday Times et en collaboration
avec le professeur de français. Une autre classe
de 3e étudie des journaux anglais, américains
et australiens (structure, nature des articles, liste des
rubriques, spécificité du journal, etc.)
En
arts plastiques, les élèves de 3e analysent
les publicités dans les magazines du colis presse
à partir de la grille d'analyse d'une image de publicité.
En
espagnol, les élèves travaillent sur le
quotidien El Pais: vocabulaire de la presse; structure
du journal; comparaison avec un journal français;
analyse d'un article en 3e; illustration de la météo
en 4e.
En
français, et pour tous les niveaux, les professeurs
consacrent un moment à la découverte d'un
journal (voire de plusieurs) envisagé comme entreprise,
organe d'information et organe d'opinion.
En
6e, les élèves abordent la presse écrite
sous plusieurs niveaux:
- expression orale à partir de la carte météo:
les élèves font le bulletin météo,
- expression écrite: ils relèvent et corrigent
les coquilles,
- étude des discours: ils font varier les formes
du discours injonctif dans la recette du jour et analysent
les variations du discours narratif du fait-divers au récit
littéraire.
Les
élèves de 5e, en relation avec l'épreuve
comptant pour l'attestation de sécurité routière,
travaillent sur des faits divers relatant des accidents
de la route: analyse des circonstances, des causes, des
conséquences, des personnes impliquées. Au
terme de ce travail, ils réalisent une synthèse.
La
classe de 4e étudie la composition d'un quotidien
régional, national, d'un magazine (nature des articles)
et aborde les règles de l'écriture journalistique
(titre, chapeau, attaque, développement, conclusion).
A partir de l'étude de deux faits divers, les élèves
rédigent un article destiné à la presse
locale. Enfin, la visite au "Carrefour carrières"
fait suite à la rédaction d'un compte rendu
à paraître dans le journal du collège,
après correction du premier article.
En
3e, les élèves travaillent sur différents
sujets. La journée du 8 mars consacrée à
la femme a amené une réflexion sur la presse
et la place des femmes dans celle-ci. Les élèves
étudient également le dessin de presse en
tant que discours argumentatif. Ils différencient
les différents types d'articles (brève, éditorial,
interview, article d'information). Un travail est organisé
sur des dépêches de la journée (les
retrouver dans un quotidien, commenter leur développement
et le choix fait par la rédaction: pourquoi certaines
ont fait l'objet d'un article et d'autres non). Ces dépêches
sont utilisées pour élaborer la "Une" d'un
journal avec le logiciel Publisher. Enfin, la relation du
roman étudié en classe (Malataverne
de B. Clavel) avec des articles et des faits divers permet
d'élargir la réflexion sur les problèmes
de délinquance.
 En
histoire-géographie, les élèves
de 6e sélectionnent un article dans un quotidien
qu'ils ont lu. Ils le présentent et l'expliquent
devant la classe. En 4e, les médias permettent au
professeur d'aborder de façon différente la
carte de France des régions. Les classes de 3e travaillent
sur les élections et sur la presse clandestine pendant
l'Occupation. Le thème des élections est repris
par les élèves de 5e, notamment avec la perception
du résultat des élections dans des journaux
de différentes tendances. En
histoire-géographie, les élèves
de 6e sélectionnent un article dans un quotidien
qu'ils ont lu. Ils le présentent et l'expliquent
devant la classe. En 4e, les médias permettent au
professeur d'aborder de façon différente la
carte de France des régions. Les classes de 3e travaillent
sur les élections et sur la presse clandestine pendant
l'Occupation. Le thème des élections est repris
par les élèves de 5e, notamment avec la perception
du résultat des élections dans des journaux
de différentes tendances.
 En
mathématiques, les élèves de 3e
et de 4e utilisent Le Courrier picard pour leur étude
des résultats des élections cantonales: En
mathématiques, les élèves de 3e
et de 4e utilisent Le Courrier picard pour leur étude
des résultats des élections cantonales:
a) calculs faisant intervenir des pourcentages:
- application directe d'un pourcentage,
- calcul d'un pourcentage,
- calculs spécifiques sur le nombre d'abstentions.
b) diagramme semi-circulaire:
- lecture directe et représentation en pourcentages,
- calculs d'angles et réalisation du diagramme.
c) explication sur le nombre de sièges obtenus avec
la règle du plus fort reste: calculs correspondants.
d) explication du lexique électoral (votants, inscrits,
exprimés, nuls, abstentions...).
e) interdisciplinarité français-mathématiques:
les femmes dans la société (calcul de la place
des femmes dans les élections au Conseil général
et au Conseil régional).
En
biologie, et en interdisciplinarité avec le français,
les élèves devaient aborder la bioéthique
à partir des articles de Science et vie junior,
du Monde et d'une émission de télévision.
Cette action ne s'est pas réalisée.
 Conclusion Conclusion
De cette action, nous pouvons tirer plusieurs observations.
Il est clair que l'utilisation de la presse et des médias
audiovisuels favorise au même titre que d'autres supports
la réalisation de plusieurs objectifs de l'éducation:
construction d'une conscience citoyenne, maîtrise
des langages et formation d'une culture partagée.
La prise directe sur le monde réel, sur les événements
actuels et proches ne peut qu'augmenter la motivation des
élèves, comme en témoignent leurs commentaires
personnels, même s'il faut moduler cet aspect positif
au regard de la nouveauté de la démarche proposée
ce jour-là.
Ces journées ont permis une réelle entente
interdisciplinaire. Une dynamique est maintenant amorcée
puisqu'il est question de rééditer l'opération
qui figure d'ailleurs maintenant dans le projet d'établissement.
A la lumière de l'expérience tentée
cette année, elle pourra s'intégrer plus sûrement
dans des projets de classe et rassembler davantage de personnes.
A ce titre, la semaine de la Presse dans l'Ecole continuera
à être un moment fort de la vie de l'établissement.
retour
à la liste des témoignages
 [Haut] [Haut]
|
"Lisez-moi!",
un journal de collège créé avec
des professionnels
Collège
Jean-Bullant, Ecouen. Extrait du rapport national de
la 10e semaine de la presse dans l'école.
|
|
|
"Lisez-moi!"
ne ressemble pas aux autres journaux que produisent les
enfants du collège Jean-Bullant. C'est particulièrement
frappant dans la maquette, mais les textes ne sont pas en
reste. Il était donc intéressant de chercher
à savoir comment cette équipe avait pu mener
à bien ce projet.
 Chronologie du projet
Chronologie du projet
Le
"projet journal" a été construit en 1998-1999,
dans le cadre d'un parcours diversifié. Il est piloté
par deux enseignantes, un professeur d'histoire et géographie,
Nelly Benabou, et un professeur de français, Anne
Richard. Toutes deux travaillent avec un journaliste professionnel,
Antoine de Ravignan.
Leur objectif: "Dans le cadre de l'éducation à
la citoyenneté, il nous a paru important de sensibiliser
les élèves aux problèmes des droits
de l'homme, de les rendre actifs et autonomes, de permettre
à certains de révéler des qualités
inexploitées dans le cadre scolaire".
Pour cela, elles décident de réaliser un numéro
spécial d'un journal scolaire sur les droits de l'homme.
Cela permet, outre d'approfondir le thème choisi,
de comprendre les diverses étapes de la fabrication
d'un journal de la page blanche à l'impression, de
jouer enfin un autre rôle que celui du lecteur et
de devenir "journaliste", producteur d'information.
 Les grandes étapes
Les grandes étapes
-
En janvier, le projet est annoncé aux élèves
et aux parents, et plusieurs séances sont menées
en collaboration avec le journaliste. Il explique "la chaîne"
d'un journal (2 heures en classe), aide pour la conférence
de rédaction et l'élaboration du sommaire
avec les élèves. A la demande des élèves,
une partie du journal focalise sur les droits de l'enfant
et, en particulier, le problème des enfants travailleurs.
Les élèves découvrent les différents
types d'articles: Une, brève, faits divers, article
de fond, etc... puis redéfinissent plus précisément
leurs sujets, avec les contraintes de calibrage.
-
En février, les journalistes en herbe font des recherches
et apprennent à vérifier leurs sources d'informations.
Ils préparent leurs questionnaires et leurs plans
de recherche, prennent les rendez-vous par téléphone
ou par courrier parfois avec l'aide de leur professeur et
vont aux rendez-vous (seuls ou accompagnés, l'autonomie
des élèves étant favorisée).
En cours d'art plastiques, ils illustrent la convention
des droits de l'enfant.
Ils rédigent et corrigent leurs articles en classe
et à la maison. Fin février, ils remettent
leurs premières versions aux professeurs et au journaliste.
-
En mars, c'est le commentaire critique des articles avec
le journaliste. Comment corriger, titrer, chapeauter? Les
élèves font les ultimes corrections et saisissent
leurs articles sur ordinateur (cours de technologie).
Le montage du journal est confié à une maquettiste
professionnelle qui vient expliquer son métier aux
élèves. La maquette est soumise à la
classe pour les dernières modifications avant envoi
à l'imprimeur. Les élèves visitent
l'imprimerie où est tiré le journal.
Le journal est ensuite vendu par les élèves
dans leur entourage.
 Moyens financiers
Moyens financiers
-
Journaliste : 5.000 Francs (projet d'établissement).
- Maquettiste : 2.500 Francs sur la vente des journaux.
- Imprimeur : gratuit (parent d'élève).
- Professeurs : 10 HSE chacun.
retour
à la liste des témoignages
 [Haut] [Haut]
|
Un
concours sur l'image d'information: une proposition
Clemi pour l'académie de Rennes
Compte
rendu de l'équipe Clemi de Rennes. Extrait du
rapport national de la 10e semaine de la presse dans
l'école. |
|
|
A
partir d'une photo de l'AFP envoyée à toutes
les classes inscrites, les élèves doivent
produire un court texte journalistique orientant sa signification.
Nous
sommes partis de quelques constats. Nous subissons quotidiennement
toutes sortes de bombardements d'images. Ces images présentent
des effets de réalité qui laissent croire
qu'elles sont la réalité. L'approche de l'image
est une recommandation forte des programmes et instructions
de l'Education nationale en France. Peu d'enseignants encore
proposent à leurs publics des activités de
découverte, d'analyse ou de production d'images.
De là l'idée de proposer une action plus spécifiquement
centrée sur l'image d'information aux établissements
de l'académie.
 Les objectifs de travail
Les objectifs de travail
- Observation attentive d'une photo d'information non légendée
et recherche d'indices sur lesquels édifier du sens.
- Production d'un écrit journalistique (titre, sous-titre,
intertitres, chapô, légende…) de 250 mots
maximum, s'appuyant sur les indices relevés et offrant
une interprétation cohérente de ce que représente
la photographie proposée.
 Réflexion attendue chez les participants
Réflexion attendue chez les participants
- Toute photographie est le produit d'une subjectivité
tendue vers une autre subjectivité.
- La photographie d'information n'échappe pas cette
règle, d'autant moins que la fenêtre qu'elle
ouvre sur le monde renforce les effets de réel.
- Si toute photographique est polysémique, toute
photographie d'information se doit d'être légendée
afin de sélectionner un sens et un seul, celui qui
va mettre le lecteur de presse dans les conditions de compréhension
maximales.
 Modalités spécifiques
Modalités spécifiques
L'AFP Ouest, en la personne de son directeur, s'est totalement
impliquée dans cette action, notamment en recherchant
dans ses archives le document photographique le plus attractif
et le plus susceptible de susciter la créativité
des participants. La photographie en couleurs retenue, réalisée
par Sergei Ilnitsky, a été rendue libre de
droits. Chaque classe inscrite a reçu le règlement
du concours ainsi que des photocopies couleur.
Afin que le travail initial d'observation de la photographie
prenne tout son sens, il fallait que le document transmis
aux participants soit d'une qualité proche de l'original.
C'est la Caisse d'Epargne de Bretagne qui a financé
les travaux de reprographie couleur en nombre, et c'est
encore elle qui a doté le concours de prix. La classe
gagnante, notamment, s'est vu offrir un appareil photo numérique.
 Bilan
Bilan
151 textes nous sont parvenus. Le document photographique
d'appui a donné lieu à un grand nombre d'interprétations,
mais les consignes de travail ayant été remarquablement
suivies, on a pu observer, dans l'immense majorité
des cas, la grande cohérence entre l'interprétation
de la photographie et le texte journalistique d'accompagnement.
Les classes primées ont été invitées
à une remise des prix récréative à
l'école Pablo Picasso, à Rennes. Les enseignants
ont expliqué le travail réalisé par
les enfants aux parents d'élèves présents
et aux partenaires, extrêmement satisfaits de l'opération.
Toutes les classes participantes ont reçu une plaquette
réalisée par le Clemi, comprenant un choix
de textes représentatif de la variété
de leurs interprétations, ainsi qu'une suite de deux
autres photographies couleur qui sont venues compléter
la première.
retour
à la liste des témoignages
 [Haut] [Haut]
|
|
Radio-Collège,
une initiative citoyenne faite par et pour les jeunes
Témoignage
de Antoine Anton, conseiller d'éducation et
responsable de la radio
|
la
liste des radios en milieu scolaire en France
|
|
La
semaine de la Presse dans l'Ecole est souvent à l'origine
de la création d'un journal ou d'une radio dans les
établissements scolaires. Pourtant, des initiatives
n'ont pas attendu la Semaine pour se mettre en place. C'est
le cas de Radio-Collège qui, depuis déjà
15 ans, émet sur les ondes locales l'actualité
disséquée et analysée par les élèves
du collège d'Aytré (17). Chronique d'une matinée
sur Radio-Collège pour la préparation d'"Hebdo
mag", le rendez-vous radiophonique de l'information.
 Lundi
16 mars 1998, 10h20: récréation Lundi
16 mars 1998, 10h20: récréation
Alors que la plupart des élèves gagne
la cour de récréation pour un quart d'heure
de pause, une dizaine de collégiens rejoint une salle
annexe du centre de documentation et d'information (CDI)
dans laquelle sont proposés quotidiens, magazines
et hebdomadaires.
"Quoi
de neuf cette semaine ?"
On parcourt les "Unes". On feuillette rapidement les revues.
On lit en diagonale les articles et on commence à
relever ce que sera l'actualité de la semaine.
"Y'
a un dossier sur le racisme dans Les Clés de l'Actu!"
"T'as vu, c'est la semaine mondiale de l'eau."
"Pas la semaine, c'est juste dimanche!"
"Y a tout un papier sur I AM dans Mon Quotidien, pour la
rubrique: Décrassez vos baladeurs!"
10h30,
conférence de rédaction, autour de Frédéric,
le médiateur.
"T'as le conducteur ? Bon, alors, qu'est-ce qu'on retient
pour "l'Hebdo Mag" de vendredi ?"
Dans l'urgence, les propositions retenues sont notées,
le conducteur se complète, rubrique après
rubrique. On négocie, on défend ses choix,
on hiérarchise, comme disent les pro.
10h35,
sonnerie: fin de récréation.
Pendant que les élèves rejoignent les cours,
Frédéric photocopie les articles retenus et
les classe dans une chemise accessible aux élèves
durant leurs moments de liberté. Généralement,
l'interclasse de midi. Ainsi, nos jeunes journalistes pourront-ils,
armés de surligneurs ou de ciseaux, résumer
l'article choisi de façon plus ou moins orthodoxe,
avant d'entreprendre la réécriture du papier
pour la rubrique dont ils sont les rédacteurs.
 Vendredi
20 mars, 12h20: interclasse Vendredi
20 mars, 12h20: interclasse
Passage prioritaire au self, déjeuner sur le
pouce avant de regagner la salle de travail. On fait le
point, dans l'urgence, rubrique par rubrique, pendant que
Stéphanie finit d'écrire les derniers lancements,
petits textes courts d'introduction destinés, mieux
que les "Sans transition aucune...", à amener les
différents sujets. Quelques frictions ou éclats
de voix. Filage rapide avant l'émission.
12h50:
Studio.
Toute l'équipe de "Hebdo Mag" rejoint le studio de
direct, se positionne autour des micros. Stéphanie
coiffe son casque et vérifie, auprès de Thierry,
le technicien, le bon fonctionnement des retours.
"Rouge antenne dans une minute !" annonce la voix de Thierry
dans les retours.
Silence total dans le studio. On respire à fond,
les yeux rivés sur le bras levé du technicien,
derrière la vitre qui sépare de la régie.
Le bobino de l'indicatif de l'émission se déroule
inexorablement sur le Revox, le bras se baisse, donnant
le signal d'ouverture des micros.
13h:
Antenne.
"Bonjour! Heureux de vous retrouver sur Radio-Collège
pour "Hebdo Mag", le seul magazine d'actualités réservé
aux moins de seize ans. Au sommaire, cette semaine..."
Alors, un quart d'heure durant, rythmée par les virgules
musicales, courtes pauses pendant lesquelles on cède
sa place au micro à l'intervenant suivant, l'actualité
de la semaine revue et préparée par les collégiens
parcourt les ondes de l'agglomération rochelaise,
à la rencontre d'un auditorat potentiel de cent mille
auditeurs.
 Un
projet pédagogique Un
projet pédagogique
Radio-Collège n'est pas une radio pour rire.
Depuis plus de quinze ans, vaille que vaille, coûte
que coûte, elle émet comme une grande sans
discontinuer. Diversité de la presse, traitement
de l'info, travail journalistique, l'équipe de "Hebdo
Mag" et celles des autres magazines réalisés
quotidiennement sur Radio-Collège n'attendent pas
la semaine de la Presse pour en saisir le fonctionnement,
en percevoir la nécessité mais aussi les contraintes.
Et, alors que s'affirme l'évidence, sinon l'urgence,
qu'il ne peut y avoir d'éducation à la citoyenneté
sans éducation aux médias, Radio-Collège,
au quotidien, tente de contribuer à la formation
de ceux qui, demain, auront à participer à
la vie de la cité.
 Les
suites du travail Les
suites du travail
Ce texte est paru dans le cahier spécial "Initiatives
Citoyennes" de la lettre de l'académie de Poitiers,
en mai. Radio-Collège attendait la ministre déléguée
chargée de l'Enseignement scolaire le 15 mai 1998,
dans le cadre de la valorisation des initiatives citoyennes.
La rencontre ayant été annulée la veille,
Radio-Collège a été en communication
téléphonique avec Mme Ségolène
Royal pour un numéro spécial de 20 minutes
des "Clés de l'Actu" entièrement consacré
aux initiatives citoyennes, présenté par les
6e A et leur professeur d'histoire.
Avec beaucoup de professionnalisme, les élèves
ont éclairé les concepts de citoyen, de citoyenneté,
de civisme, rappelé les textes fondateurs des droits
de l'homme et de l'élève, les commémorations
qui, cette année, célèbrent ces droits
et la dignité de l'homme.
Un envoyé spécial au lycée Marcel-Dassault
de Rochefort a interrogé les délégués
et le proviseur pour qui la question essentielle est de
savoir "comment responsabiliser les élèves
?". A cette question et à celle de Guillaume, élève
de 6e, sur les projets de Madame la ministre pour améliorer
la vie des collèges, cette dernière a proposé
la prise de parole des élèves contre la loi
du silence, la prise de conscience de la conséquence
de leurs actes en les leur faisant assumer, les sanctions
éducatives collectives, l'amélioration de
l'accueil des élèves, l'orientation, l'évaluation
qui devrait mettre l'accent sur ce qui est positif dans
les aptitudes des élèves, l'instruction citoyenne.
Les
élèves ont été remerciés
pour la qualité de leur émission et de leur
réflexion. Ils ont renouvelé leur invitation
à Madame la ministre.
retour
à la liste des témoignages
 [Haut] [Haut]
|
|
Débattre
avec des journalistes, ça se prépare!
Lycée Robillard, dans le Calvados.
Extrait du rapport national de la 10e semaine de la
presse dans l'école.
|
|
|
Voici
le déroulement de la semaine de la presse dans l'école
telle que nous l'avons vécu au lycée Robillard.
Pour concocter ce volumineux programme, nous avons bien
sûr travaillé en équipe. Nous avons
utilisé le Médiasid édité par
la Documentation Française (pour les coordonnées
des médias) et le site Internet du Clemi. Un conseil:
il faut surtout du culot et ne pas hésiter à
contacter des journalistes qui, bien souvent, n'attendent
que cela!
 En presse écrite
En presse écrite
Le
kiosque, réalisé grâce au "colis presse"
d'une trentaine de magazines, a été l'occasion
de ce que, traditionnellement, nous appelons un "bain de
presse". Des élèves de première ont
ainsi feuilleté pendant 3 heures et découvert
des parutions dont ils ne soupçonnaient parfois même
pas l'existence. Ils ont essayé de définir
des critères de différenciation entre les
types de périodiques et surtout, ils ont débattu
sur la pluralité de la presse et ses conséquences
possibles. Ce travail avait fait l'objet au préalable
de plusieurs cours sur les médias. Il fut suivi d'autres
séances liées à ce thème.
 En radio
En radio
Le
premier intervenant extérieur de cette Semaine fut
un journaliste de la radio locale Normandie FM, Monsieur
Mas, qui accepta de présenter le journal de la mi-journée
en direct du centre de documentation et d'information du
lycée. La classe de première année
de BEP, qui a au programme l'étude des médias
de proximité, avait préparé cette intervention.
Elle a pris part à l'animation et à l'enregistrement
de l'émission. Le passage en direct fut un moment
de grande angoisse mais aussi de réel plaisir pour
les jeunes. Ils n'eurent pas trop des deux heures que le
journaliste leur accorda après l'émission
pour lui poser toutes les questions qui leur tenaient à
coeur.
 Autour du photo reportage
Autour du photo reportage
L'intervention
de Jean-Michel Turpin, photo reporter à l'agence
Gamma, s'articula autour de deux classes de première
qui avaient travaillé sur la photo de presse et sa
fonction dans le journalisme moderne. Monsieur Turpin, qui
a couvert le Rwanda, la Somalie, l'Algérie, était
venu débattre avec les jeunes de son rôle et
de la déontologie de sa profession. Le débat
tourna d'ailleurs rapidement à une mise en cause
par les élèves des "paparazzi". Cette discussion
s'enrichit également des explications, par l'auteur,
de ses clichés. D'une séance initialement
prévue pour durer 1h30, nous sommes arrivés
à une discussion qui dura plus du double.
 Réflexions et débats
Réflexions et débats
La
dernière intervention de cette semaine de la presse
était destinée en priorité aux étudiants
de BTS puisqu'ils étudient la démocratie dans
un de leurs cours. Avec les enseignants qui interviennent
dans cette filière, nous avons saisi l'occasion pour
parler des relations qui existent ou qui devraient exister
entre démocratie et médias. Plusieurs séances
d'étude furent mises en place pour préparer
la venue de Serge Halimi, journaliste au Monde Diplomatique,
professeur à l'Université Paris VIII et auteur
de l'ouvrage "Les nouveaux chiens de garde". Nous avons
associé à cette journée les autres
établissements bas-normands qui se sont déplacés
en nombre, car ce livre avait été étudié
par de nombreux étudiants. L'intervention de Monsieur
Halimi et le débat qui s'en suivit donna naissance
à d'autres débats, à des réflexions
et des travaux au cours des séances suivantes (les
étudiants de Coutances préparent un article
qu'ils comptent transmettre au journaliste).
retour
à la liste des témoignages
 [Haut] [Haut]
|
|
Une
quinzaine de la presse au collège Maryse-Bastié
de Reims
Témoignage
de Mme Wagenknecht, professeur d'histoire-géographie,
et de Mme Chrutowski, documentaliste du collège
|
|
|
Le
collège Maryse-Bastié de Reims a profité
pleinement de la 9e semaine de la Presse pour développer
le sens critique des élèves sur les médias
et l'information. Une opération menée tambour
battant durant deux semaines, qui a permis d'organiser de
nombreuses activités dans et hors l'établissement
scolaire.
 La
mise en place, le concours La
mise en place, le concours
Dès le lundi 16 mars 1998, différentes
activités se mettent en place dans le cadre du nouveau
centre d'information et de documentation (CDI), notamment
l'installation du kiosque et l'ouverture du "concours presse":
dix questions sont écrites par des élèves
et proposées à tous, de la 6e à la
3e et Segpa. Chaque participant doit lire les magazines,
puis répondre aux questions. Les bulletins sont déposés
dans une urne. Les résultats et les récompenses
seront donnés le vendredi 10 avril.
 Les
activités de la quinzaine Les
activités de la quinzaine
Des classes vont se succéder au CDI afin de participer
à diverses activités à partir d'un
emploi du temps précis du lundi 16 mars au vendredi
27 mars (eh oui! la semaine de la Presse dans l'Ecole a
joué les prolongations...).
A
partir de la presse écrite, les élèves
comparent la "Une" de différents quotidiens régionaux,
et réalisent eux-mêmes leur propre "Une". A
partir d'un questionnaire, ils analysent plusieurs faits
divers sur les avalanches en montagne. Enfin, ils sont invités
à consulter les magazines et les journaux du kiosque,
puis à organiser un débat.
En
matière d'audiovisuel, la projection de plusieurs
journaux télévisés (deux chaînes
nationales, une chaîne européenne, une chaîne
internationale) amène les élèves à
réfléchir sur la place donnée à
l'information, l'ordre et l'importance des sujets présentés.
Ils comparent également deux reportages enregistrés
sur deux chaînes différentes, TF1 et
FR3, autour d'un même sujet: l'assassinat du
préfet de la Corse. Enfin, deux projections leur
sont proposées qui amèneront une analyse:
- un reportage court présenté sur France
2 sur la fabrication des saxophones par l'entreprise
Selmer. Un questionnaire est donné aux élèves
à l'issue de la projection.
- la cassette réalisée sur le journal Ouest-France,
dans le cadre de l'émission de France 3 "C'est
pas sorcier", sur les thèmes de l'acheminement de
l'information et la réalisation d'un quotidien régional.
Après
chaque activité, une fois les questionnaires remplis,
des débats sont organisés sur des thèmes
différents: l'information à travers les médias,
l'acheminement de l'information, le métier de journaliste,
la liberté de la presse.
 La
Semaine, c'est aussi hors du collège La
Semaine, c'est aussi hors du collège
Le lundi 16 mars, la classe de 4e technologique s'est
rendue à Radio France Champagne: visite, découverte
des locaux, rencontre avec les animateurs et surtout suivi,
en direct, de la préparation de réalisation
de différentes émissions. Les élèves
ont été touchés par l'accueil reçu
à Radio France Champagne.
Le
mardi 17 mars, les mêmes élèves se sont
retrouvés à 22 heures au siège du quotidien
régional L'Union pour la visite des locaux.
Ils ont été pris en charge par une hôtesse
fort sympathique. Une visite des plus intéressantes
a commencé... Vers 23h30, tout le monde a rejoint
les ateliers de fabrication du journal: rotatives, papier,
encre... bruit. Tout cela a ébahi le groupe! On s'est
quitté vers 1heure du matin après une grande
satisfaction et une réelle découverte. Merci
au journal L'Union. Merci à notre hôtesse
et surtout merci au personnel qui, malgré la lourde
tâche, a accepté de répondre très
gentiment aux questions des élèves.
Le
mardi 24 mars, dans le cadre d'un projet du Clemi, la classe
de 4e technologique et la classe de 3e d'insertion du collège
Paul-Fort se sont rendues à Paris. Au programme:
Visite de Radio France avec la découverte
de la Maison de la radio et du musée de la radio
et de la télévision. Participation à
l'enregistrement de l'émission de télévision
"Le Bigdil", animée par Vincent Lagaf. Les élèves
ont visité le plateau avec l'équipe de tournage.
Ce fut une journée merveilleuse et bien remplie.
Ces
expériences ont permis aux élèves de
4e techno de préparer une exposition dans le cadre
du projet "Autour des médias".
retour
à la liste des témoignages
 [Haut] [Haut]
|
|
La
7e semaine de la Presse au collège Pierre-Brossolette
du Perreux
Témoignage
de Mme Trabys, documentaliste, juin 1996
|
|
|
En
1996, le collège Pierre-Brossolette du Perreux (94)
renouvelle son rendez-vous avec la presse. Certains élèves
l'ont même tant attendu et tant désiré
qu'ils ont commencé à le préparer...
en avril 1995! L'aventure commence donc juste après
la 6e semaine de la Presse dans l'Ecole.
 Et
si on créait un club de la presse... Et
si on créait un club de la presse...
Des élèves de cinquième ont rencontré
des journalistes. Leur enthousiasme et l'intérêt
évident qu'ils portent à l'actualité
m'enchantent: je vais pouvoir sortir du cadre un peu
étroit de la Semaine pour lancer une action sur
un plus long terme. 15 élèves me suivent,
ravis, dans la création immédiate d'un "club
de la presse" qui, une fois par semaine, au CDI, débat
librement autour des thèmes de l'actualité.
Pierre Billaud et Alain Le Gouguec, journalistes à
France Inter, acceptent avec intérêt
de s'associer à nous, pour un projet à définir
l'année suivante.
Dès la rentrée, en septembre, le club de la
presse reprend ses rendez-vous hebdomadaires, au CDI, pendant
la pause du déjeuner.
Le projet est précisé avec les journalistes:
former les élèves pour les amener à
réaliser des reportages qui seront diffusés
à l'antenne de France Inter pendant la prochaine
semaine de la Presse.
Dès lors, deux actions sont menées en parallèle.
 Des
débats autour de l'actualité Des
débats autour de l'actualité
Objectifs majeurs:
- comprendre que la richesse d'un débat naît
de la diversité des opinions, apprendre à
écouter, apprendre la tolérance,
- développer le goût de l'information,
- analyser les différents modes d'accès à
l'information.
Dans cet esprit, les élèves décident
d'arbitrer les débats à tour de rôle.
Les sujets sont choisis à partir d'un tour de table
où chacun, à la manière d'une revue
de presse, présente les événenents
qui l'ont intéressé dans la semaine.
Supports utilisés: essentiellement la presse écrite
(surtout le Journal des enfants et les Clés
de l'actualité auxquels le CDI est abonné).
Mais des références nombreuses sont faites
au journal télévisé de 20h et aux bulletins
d'information sur France Inter.
 Apprentis
journalistes Apprentis
journalistes
Une part de notre temps est consacrée chaque semaine
à la préparation de l'objectif principal de
l'année: réaliser des reportages.
Déroulement
- écoute et analyse de bulletins d'information et
de reportages radiophoniques,
- conseils de base pour réaliser un reportage (notions
d'angle d'attaque, de relance, règle des "5W", loi
de proximité, etc.),
- analyse autocritique des reportages réalisés
pendant la 6e Semaine,
- interventions ponctuelles, au CDI, de Pierre Billaud et
Alain Le Gouguec,
- analyse des reportages effectués par les élèves,
- manipulation du magnétophone Nagra,
- ateliers d'écriture radiophonique et de reportages.
Le
projet pour la 7e semaine de la Presse
En janvier, conférence de rédaction au CDI,
avec les deux journalistes, pour choisir les sujets et définir
la forme sous laquelle ils seront traités. Seront
ainsi réalisés:
- un micro-trottoir à partir de la question suivante:
"Comment réagiriez-vous si vous receviez un poème
de forme sextine?",
- une interview d'un professeur du collège: double
visage de la banlieue,
- un "paquet-cadeau": Claude Sérillon, journaliste
à France 2 et Pascal Pannetier, localier au
Perreux, font-ils le même métier?
Temps fort de nos activités, notre rendez-vous avec
Claude Sérillon qui répond très gentiment
aux questions des jeunes "journalistes" dans son bureau
de France2. Nouvelle rencontre avec Pierre Billaud
et Alain Le Gouguec pour analyser, corriger ce qui a été
réalisé, puis enregistrement dans les studios
de France Inter. Le montage est assuré par
les journalistes.
Un reportage est sélectionné et passe à
l'antenne de France Inter, le lundi ler avril, premier
jour de la 7e semaine de la Presse, pendant le journal de
7h. A noter que la presse locale, Le Perreux notre cité
et le Républicain du Val-de-Marne, s'est l'écho
de notre aventure dans ses colonnes.
 Quoi
d'autre au collège pendant la Semaine? Quoi
d'autre au collège pendant la Semaine?
Les activités liées au Club de la presse m'ont
laissé peu de temps, cette année, pour organiser
des rencontres avec des journalistes pendant la semaine
de la Presse. Néanmoins, des animations diverses
ont eu lieu au CDI. Les élèves ont pu y feuilleter
durant toute la semaine les nombreux journaux et magazines
obtenus grâce aux NMPP, et en apprécier la
diversité.
Les deux groupes d'élèves de sixième
de l'atelier CDI (atelier hebdomadaire) ont analysé
"les caractéristiques de la presse d'information
pour les jeunes" à travers les Clés
de l'actualité junior. Chacun d'eux a bénéficié
d'un exemplaire gratuit grâce au correspondant local
des éditions Milan.
Une classe de cinquième, accompagnée d'un
professeur de mathématiques soucieux de faire
participer ses élèves à la semaine
de la Presse, a conçu une exposition sur le thème:
"Les hommes et les femmes qui font l'actualité".
Armés de colle et de ciseaux, ils ont recherché,
dans la presse quotidienne et hebdomadaire d'information,
les personnages le plus souvent représentés.
Ils les ont classés par thèmes: politique
internationale, France (politique et société),
médias et arts (littérature et musique), cinéma,
sport. Cinq panneaux ainsi réalisés ont été
exposés sous le préau.
Un professeur de français a choisi de faire réfléchir
ses élèves sur la presse à sensation.
Ce travail s'est effectué en trois temps:
- une rédaction sur le thème pour susciter
la réflexion,
- une séance d'analyse de la presse au CDI: répartis
en 8 groupes, les élèves ont feuilleté
les titres les plus connus (Voici, Gala, Ici
Paris, France dimanche...) et, à partir
d'une grille, analysé les personnages, les thèmes,
le vocabulaire, les titres, les images, le public visé,
- un bilan pour tirer les conclusions de leur réflexion.
 Le
bilan des activités du club de la presse Le
bilan des activités du club de la presse
Les débats hebdomadaires
- Les élèves ont appris à s'écouter
les uns les autres, et leurs discussions se sont enrichies
de la diversité de leurs opinions.
- Leur curiosité grandissante pour l'actualité
a progressivement poussé leur intérêt
vers des événements qui ne faisaient pas forcément
la "une".
- Leur esprit critique s'est développé face
au traitement de l'information par les différents
médias.
Le
travail avec les journalistes
- Découverte d'une radio peu ou pas connue par les
élèves, France Inter, de la diversité
et de la qualité de ses émissions.
- Meilleure connaissance du travail des journalistes.
- Apprentissage de l'écriture radiophonique et des
techniques du reportage... Et si l'on écoute certains
de nos apprentis-journalistes, des vocations se sont révélées...
Affaire à suivre, sur les ondes radiophoniques...
dans quelques années !
Des
prolongements
En mai, visite à la Maison de Radio-France. Au programme:
- le 13h-14h de Jean-Luc Hees,
- le musée de la radio,
- les studios d'enregistrement.
Et bien sûr, le club de la presse se retrouve tous
les mardis, mais l'heure hebdomadaire suffit de moins en
moins pour débattre de tous les sujets qui passionnent
les élèves.
 Le
bilan général Le
bilan général
La curiosité des enfants et des adolescents,
que l'on peut mesurer chaque fois que l'on organise des
activités autour de la presse, ne peut que nous encourager
à développer des actions en ce sens.
Travailler sur l'actualité, aider les élèves
à comprendre le monde qui les entoure, c'est une
démarche nécessaire et passionnante qui répond
à une réelle demande. Elle trouve sa juste
place dans un projet d'établissement soucieux
d'ouvrir le collège sur le monde extérieur
et s'inscrit parfaitement dans le cadre d'une pédagogie
d'éducation à la citoyenneté.
retour
à la liste des témoignages
 [Haut] [Haut]
|
|
La
semaine au centre pénitentiaire du Galet, à
La Réunion
|
|
|
L'école
du centre pénitentiaire du Galet a décidé
de participer à la 7e semaine de la Presse dans l'Ecole.
L'idée de son directeur: faire venir des journalistes,
et rendre possible le dialogue autour de l'information et de
son traitement par les médias.
 L'idée
de départ L'idée
de départ
En prévision de la 7e semaine de la Presse dans
l'Ecole, le directeur de l'école du centre pénitentiaire
a décidé d'organiser la venue de journalistes.
La possibilité d'un dialogue entre les détenus
et les journalistes a semblé intéressant aux
organisateurs, eu égard à l'intérêt
réciproque des uns envers les autres. La lecture
des quotidiens et surtout des faits divers, et les réactions
des détenus, parfois vives, dont sont témoins
les responsables du centre, laissaient augurer des échanges
riches.
D'autre part, l'école spécialisée
du centre pénitentiaire édite un journal:
Le Galet, né en 1991 pour permettre la libre
expression de la population carcérale. Les personnes
qui constituent l'équipe de rédaction ont
souvent manifesté le désir de rencontrer des
professionnels dans le souci d'améliorer leur approche
du journalisme, leur manière d'écrire...
Les diverses animations élaborées lors de
la semaine de la Presse dans l'Ecole ont eu pour cadre le
centre de ressources multimédia. Elles ont été
matériellement rendues possibles grâce à
l'engagement de l'équipe de rédaction du Galet.
Cette petite équipe, composée de six détenus,
a été active dès la première
sollicitation, malgré son caractère totalement
directif (aucune information n'avait été divulguée
préalablement). Au fil des réalisations, des
propositions individuelles sont nées spontanément
et ont contribué à la richesse de l'animation,
qui a constitué le point d'orgue de la semaine.
 Le
travail de préparation Le
travail de préparation
La proposition de départ a consisté à
exploiter le Dossier pédagogique élaboré
par le Clemi. En l'absence de documentation plus étoffée,
le prélèvement d'extraits et leur mise en
valeur sur des panneaux d'affichage pouvait constituer la
première base d'une exposition. Ces informations
ont été sélectionnées selon
des critères d'intérêt, d'importance,
afin de présenter la presse d'une manière
aussi ouverte que possible.
La première étape, qui était donc l'exploitation
du document, a été suivie de la mise en valeur
proprement dite. Celle-ci a permis à chaque membre
de l'équipe de découvrir et de s'initier à
la mise en page sur le logiciel de Pao Publisher. Les réalisations
photocopiées au format A3 étaient enfin prêtes
à être installées sur les panneaux.
A ce niveau, un travail d'équipe avait démarré
de manière constructive.
-
La réalisation d'une affiche a permis à
deux personnes d'exercer, sinon leur créativité
puisqu'il s'agissait d'exploiter des éléments
existants (la couverture du dossier pédagogique),
mais plutôt leur esprit critique afin de conserver
les éléments essentiels et les mettre en valeur.
-
Un jeu de puzzle a également été
créé à partir de la "une" de journaux
découpés. Il s'agissait de reconstituer cette
"une" en tentant de battre un record de vitesse. Une autre
personne a proposé d'animer un stand de présentation
du Galet, et a pris en charge la rédaction
d'un texte informatif destiné aux journalistes. Afin
de créer un environnement à ce stand, un panneau
montrant les vingt et une couvertures du Galet depuis
sa création a été réalisé.
-
Comment organiser et mettre en valeur le brûlant désir
de questionner, voire d'apostropher les professionnels du
journalisme? Un questionnaire a été bâti
collectivement pour servir de base à la discussion,
deux volontaires se chargeant de le présenter lors
de la visite des journalistes. Un certain nombre de questions
ont constitué une mise en relief d'un questionnement
personnel parfois douloureux: "les journalistes ont-ils
le droit de tout écrire?".
Sous diverses formes, cette question est revenue cent fois
au cours de la semaine, et c'est cette question-même
qui donnait toute sa légitimité à l'action
entreprise. Les organisateurs prenaient le risque de laisser
s'épancher une certaine amertume, mais ils offraient
aussi la possibilité que chacun puisse faire comprendre
à l'autre son point de vue. L'un sa douleur et l'autre
les nécessités d'un métier difficile.
Tout dialogue suppose une prise de risque...
-
D'autres ont exprimé leur idée de la presse
en sélectionnant les journaux devant figurer sur
les présentoirs. L'atelier écriture a choisi
les mots propres à traduire au plus près ce
que chacun ressentait à l'égard de ce qui
est écrit dans la presse. Un panneau composé
des principaux titres de la presse française découpés
et collés a été baptisé "Dans
l'Œil de la presse", un clin d'oeil au cyclone Itelle
qui n'est pas passé loin. "Une goutte d'eau dans
l'Œil de la presse" a dit, sentencieusement, le
facétieux de service. "Tu te fous le doigt dans l'Œil
de la presse" lui fut-il répondu de manière
fort irrévérencieuse par l'impertinent, mais
l'essentiel n'était-il pas de préserver le
petit sourire intérieur ou le grand éclat
de rire que l'on échange dans une équipe?
 Le
jour J Le
jour J
Le jeudi 18 avril s'est tenue la véritable animation.
Les panneaux de l'exposition et les présentoirs ont
été installés face au centre de ressources
multimédia, afin de réaliser un "couloir
de la presse" inhabituel. Les jeunes du CJD présents
à l'école ont pu poser leurs questions aux
membres de l'équipe du Galet, transformés
pour l'heure en animateurs.
Un peu plus tard, les "vrais" journalistes ont fait leur
apparition et chacun, l'équipe de Galet en tête,
a pu se livrer aux joies de l'interview. Nous avons eu des
échanges fructueux avec H. Schultz du Quotidien
et J. Ferrere du Journal de l'Île de la Réunion,
qui ont accepté le jeu des questions/réponses
de bonne grâce. Il y avait quelque chose de surréaliste
dans la situation: chacun cherchant chez l'autre la matière
de son article d'une manière tout aussi professionnelle;
l'histoire de l'interviewer interviewé en
quelque sorte. Sans animosité, avec respect et tolérance,
les questions de fond ont été posées;
de part et d'autre, on s'est découvert, sinon apprécié
(il faut du temps pour cela). Les organisateurs ont été
très satisfaits de la conviction avec laquelle chacun
s'est impliqué.
La matinée s'est terminée avec la remise des
prix du concours de jeux que proposait le Galet 19
(spécial Noël). Pour la circonstance, le sous-directeur
et l'équipe des enseignants ont pu présenter
leurs félicitations et leurs encouragements aux trois
heureux gagnants.
 Le
bilan Le
bilan
Quelques jours après cette manifestation, l'équipe
du Galet dresse un bilan de son action. Chacun a le sentiment
d'avoir participé à quelque chose de nouveau,
d'indéfinissable; quelque chose a changé dans
l'équipe entre le début et la fin de la semaine.
Un bilan plus académique aurait utilisé les
termes de participation, de projet d'équipe, de mobilisation,
d'investissement, de compétences transversales, etc.
Quelles
questions se sont posées les organisateurs?
- Avions-nous une idée, même vague, de
ce que pouvait être une animation autour d'un thème
?
- Avons-nous été déçus
du résultat?
- Pensons-nous pouvoir assurer d'autres animations
de ce type et surtout, quels en sont les bénéfices?
Les réponses, souvent mal formulées, mais
toujours positives et unanimes, ne laissent aucun doute
sur l'intérêt et l'enthousiasme de chaque participant.
Voilà la récompense de chaque acteur et de
chaque animateur du projet.
retour
à la liste des témoignages
d'autres témoignages

|
|
|